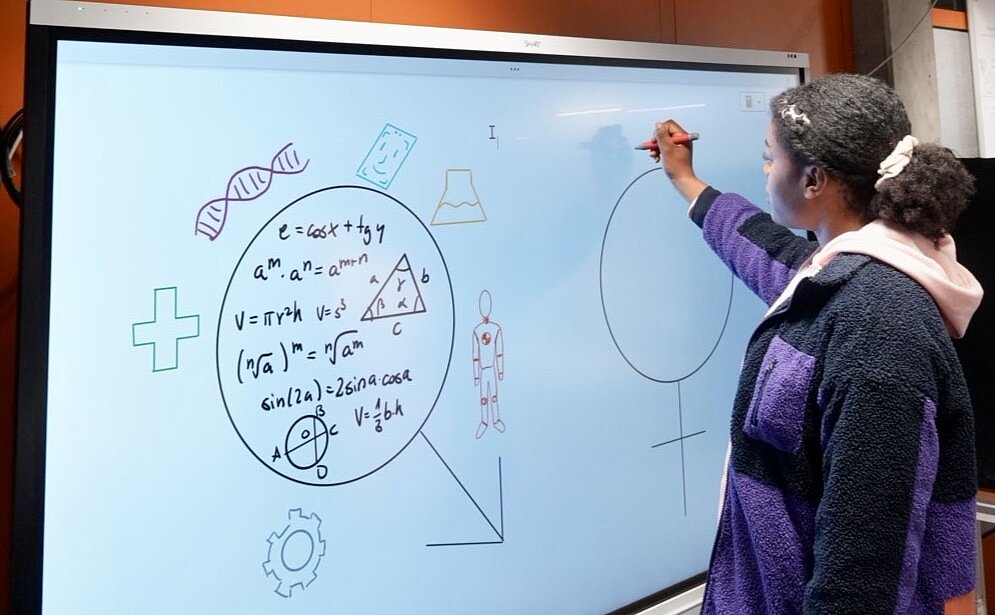Par Lomami Dende, étudiante en systèmes industriels à la HEIG-VD et ambassadrice du domaine Ingénierie et Architecture
La voiture est un moyen de transport du quotidien utilisé par la majorité d’entre nous, que ce soit pour nous rendre au travail, à l’école ou pour d’autres déplacements. Le nombre de femmes sur les routes a augmenté, bien qu’elles parcourent en moyenne moins de kilomètres que les hommes.
Cependant, les hommes et les femmes ne sont pas égaux face aux risques d’accidents. En effet, les femmes ont plus de chances d’être gravement blessées lors d’une collision frontale. Pourquoi ? Parce que les sièges, les ceintures et les systèmes de sécurité sont principalement conçus pour des morphologies masculines. Cette inégalité est due à un manque d’utilisation de mannequins féminins lors des crash-tests. Or, les différences physiologiques sont nombreuses: le cou des femmes est plus fragile, leurs épaules sont généralement moins larges et leurs hanches plus larges que celles des hommes.
L’automobile n’est pas le seul domaine concerné par cette inégalité. Dans le domaine de la santé, les recherches sur certaines maladies spécifiquement féminines, comme l’endométriose, restent largement insuffisantes alors qu’elles concernent environ 10 % de la population féminine. Dans le domaine technique, les équipements de sécurités individuels tels que les gants, les casques et les combinaisons ne sont pas adaptées à la morphologie des femmes, ce qui rendraient leur utilisation moins efficace.
Les exemples ne s’arrêtent pas là : les sièges d’avions, les bureaux ergonomiques ou même certains médicaments sont pensés pour un "standard masculin", ce qui peut avoir des conséquences négatives pour les femmes.
Enfin, il a fallu attendre récemment pour que des tests sur les protections hygiéniques soient réalisés avec du vrai sang, révélant une négligence de longue date dans la recherche et le développement de ces produits pourtant essentiels.
Tous ces exemples démontrent un problème systémique : les femmes sont trop souvent absentes des études et des recherches, non pas par manque d’intérêt, mais parce qu’elles restent minoritaires dans ces domaines, notamment en ingénierie. Pourtant, ces problématiques concernent 50 % de la population.
Il est donc crucial que les futures générations d’ingénieur·es prennent en compte la diversité dans leurs conceptions. Un projet nécessitant l’analyse des risques sur un corps féminin ne devrait pas être une exception, mais une norme. Malheureusement, les biais sexistes, les vieux codes ancrés dans notre société et le manque d’inclusivité freinent encore ces avancées.
Heureusement, les choses commencent à changer. En 2023, l’ingénieure Astrid Linder a conçu Eva SET 50F, le premier mannequin de crash-test représentant une femme moyenne, avec une poitrine, des proportions et un centre de gravité adaptés. Cette invention a mis en lumière les lacunes des crash-tests actuels et a souligné l’urgence de rendre ces pratiques plus inclusives.
Mais l’innovation seule ne suffit pas. Il est nécessaire d’aller plus loin en intégrant ces nouveaux standards dans les législations, afin que l’inclusivité devienne une norme pour toutes les entreprises et non une simple option.
La technique et l'ingénierie t'intéressent? Suis-nous sur notre page Instagram!